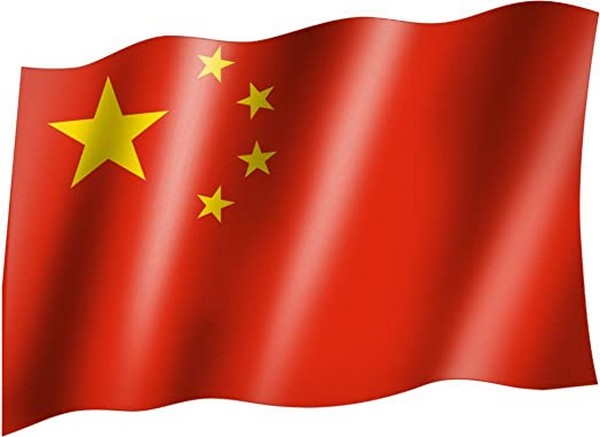Par Emmanuel Wathelet
Partie 3 Une « citoyenne ouïghoure ordinaire »? »
Une erreur dans ce dossier ? Laissez-moi un commentaire argumenté et je modifierai en conséquence. Un droit de réponse ? Contactez-moi et je le publierai.
Ce dossier est le produit d’un énorme travail d’analyse. Vous pouvez me soutenir en donnant un pourboire, unique ou à chaque publication de contenu, sur la plateforme Tipeee.
Merci aux tipeurices de la première heure, iels sont en bas d’article, merci pour vos commentaires, pour vos partages.
**
Gulbahar Haitiwaji publie, avec Rozenn Morgat, un livre qui fait beaucoup de bruit : « Rescapée du goulag chinois ». Tous les médias en ont parlé. Il semble que nous tenions là un témoignage indiscutable sur la répression et le caractère criminel de l’État chinois, dans le Xinjiang en général, sur les Ouïghours en particulier. Troisième volet de notre grand dossier dont vous pouvez retrouver la première partie ici et la seconde là.
Et la politique dans tout ça ?
D’un point de vue argumentatif, tout le livre est supposé démontrer que Gulbahar Haïtiwaji est une citoyenne ouïghoure ordinaire, non politisée, victime de la répression (du « génocide » devrais-je dire) par les autorités chinoises (entendez « Hans »). Elle « n’a jamais nourri le moindre intérêt pour la politique de son pays » (p.15) nous dit-elle, elle s’est « toujours tenue à distance des affaires politiques » (p.31 par deux fois). Les camps ? Elle n’en connaissait « même pas l’existence » (p.59). Sa fille dans une manif organisée par une association séparatiste dans laquelle son mari occupe une place importante (p.64) ? Elle ne « sai[t] pas pourquoi [cette dernière] a été à cette manifestation » (p.64) ! Gulbahar Haïtiwaji va jusqu’à affirmer qu’elle n’avait « jamais vraiment regardé ni écouté » Xi Jinping, le président chinois (p.110). La politique, « ce n’était pas [s]on truc » (p.110).
Convaincant ? Pas si sûr.
En effet, Mme Haïtiwaji indique que « par amour et peut-être par curiosité [elle a] suivi [Kerim] en décembre 1985 dans les manifestations à Ürümqi » (p.32). Ainsi, « parmi la masse de jeunes hommes et femmes emmitouflés et gonflés d’espoir qui se rassemblaient sur la place centrale de la ville se trouvaient Kerim, nos amis et moi » (p.171). Gonflé.es d’espoir, mais pas d’un espoir politique devons-nous supposer ? Qu’elle se soit « mariée à un réfugié politique » (p.101), qu’elle « pense au courage de Rebiya Kadeer », présidente du World Uyghur Congress, organisation séparatiste (p.66) et qu’elle craigne l’avoir « déshonorée » (p.178), tout cela n’implique pas du tout un engagement politique, n’est-ce pas ? Ce n’est qu’aujourd’hui, « à table quand la discussion glisse sur la politique », qu’elle « tend l’oreille » car « elle aussi à des choses à dire » (p.242). Sans blague.
Au contraire, elle se disait « effrayée » par la « colère militante » (p.31), affirmant que la politique, c’était l’affaire de son mari Kerim (p.31 toujours). Kerim en revanche est très impliqué politiquement – même si selon les intérêts de l’argumentation – le livre ne cessera d’affirmer ou de minimiser ses positionnements politiques. Par exemple, alors que Gulbahar est déjà détenue au Xinjiang, on apprend (p.51) que Kerim a des relations, qu’il peut « contacter des agents du renseignement au Xinjiang », parce qu’il « en connaît un » (p.51).

Des citoyens ordinaires, les Haïtiwaji ? Loin de là. Kerim avait des contacts rapprochés avec la police qui « l’invitait prendre le thé dans une chambre de l’hôtel de ville au Xinjiang » (p.52) où il « leur donnait suffisamment d’informations pour les rassasier, sans pour autant dévoiler la vérité sur son engagement au sein de l’Association des Ouïghours de France » (p.52 encore). Vous avez bien lu : Kerim Haïtiwaji était un informateur. Mais ce n’est pas très grave parce que les « relations policiers-interrogés prennent parfois une tournure ambigüe » (p.53), que « non, [Kerim] n’a jamais balancé personne » et qu’il « en est fier » (p.53). Ouf, du coup ?
À ce stade, on n’y comprend plus rien. La famille Haïtiwaji espionnait-elle en France pour le compte des autorités chinoises ? Kerim était-il une taupe dans l’association des Ouïghours de France ? Ou, au contraire, donnait-il ce qu’il pouvait à la Chine, histoire de servir tranquillement les intérêts états-uniens via le World Uyghur Congress ? Impossible de le savoir mais, ce qui est absolument certain, c’est qu’on n’est PAS DU TOUT face à des citoyen.nes ouïghour.es ordinaires, éloigné.es des affaires politiques. Il y a potentiellement, là derrière, une affaire d’espionnage et/ou de contre-espionnage.
Avec quel argent ?
Si l’on en croit Mme Haïtiwaji, Kerim, arrivant en France, se retrouve à « errer dans les rues de Paris » (p.36) et à « dormir en foyer d’accueil lorsqu’il trouvait une place » (p.37) malgré le fait qu’il serait parti parce qu’il « aurait eu une opportunité d’emploi » en France (p.147 – on verra plus bas toutes les incohérences liées à leur départ du Xinjiang) ; Gulbahar devra quant à elle travailler « dans un cantine de la défense » (p.48) puis « dans une boulangerie » (p.48) et Kerim, finalement, est devenu chauffeur pour Uber (p.37). Une vie modeste, donc. Très modeste.
Pourtant, l’argent ne semble pas poser de problèmes. Le nombre de billets d’avion réservés par Gulbahar Haïtiwaji dans le livre est impressionnant (p.51, p.224, p.233, p.43, etc.). Outre le fait que la famille semble s’être rendue régulièrement au Xinjiang après leur installation en France (sans le moins du monde craindre d’être arrêté.es, soit dit en passant), Mme Haitiwaji a acheté ses deux billets pour Karamay (p.43) avant de « sillonn[er] le Xinjiang » comme « un lion en cage » (p.50). Oui, elle « sillonne comme un lion en cage » un territoire de 1 665 000 km², soit plus de 54 fois la superficie de la Belgique. Bon, bon, bon, je juge pas, hein, chacun se sent à l’étroit selon sa perspective, mais on est en droit de supposer qu’elle ne l’a pas « sillonné » (c’est-à-dire « traverser d’un bout à l’autre », selon la définition) à vélo…
À propos d’argent, il est frappant de constater la bizarrerie selon laquelle quand des Ouïghour.es émigrent, ce sont celleux resté.es au pays qui leur envoient de l’argent (p.58, p.148). Une situation tout à fait inédite lorsqu’on envisage d’une part les migrations économiques vers l’Europe (et le volume d’argent renvoyé vers les pays d’origine), mais aussi lorsqu’on essaie de comprendre la nature de la « répression » des Ouïghour.es, leur « esclavage », le « travail forcé », « l’éradication », etc. dont iels sont supposé.es être les victimes.
C’est probablement que les Ouïghours n’émigrent pas pour des raisons économiques – bien que la région soit connue pour être l’une des plus pauvres de Chine (allez comprendre). Qu’est-ce que cela cache ? Explorons ceci d’un peu plus près.
Le Xinjiang n’est plus
Personne ne nie le fait que la province du Xinjiang a été particulièrement pauvre, ni d’ailleurs que son PIB a explosé ces dix dernières années. Pourtant, si l’on suit Mme Haïtiwaji, il n’y a pas là de quoi se réjouir. De son « pays de cocagne », il « ne reste plus rien » (p.21), nous dit-elle. La ville de Kashgar, au sud-ouest de la province, a vu les « joyaux de son architecture islamique broyés sous les coups de pelleteuses chinoises » (p.201).
De quels joyaux parle-t-elle ? Elle parle en fait des « petites maisons de terre » (p.201) dont on a « laissé croire aux habitants […] que [l]es transformations étaient réalisées pour leur bien » (p.201 toujours), de même que ce ne fut sans doute pas non plus pour leur bien que les autorités chinoises ont « échafaud[é] des appartements flambants neufs » pour les remplacer (p.201). Voilà, il faudrait donc regretter « les ruelles tortueuses recouvertes de larges pièces de tôles et les maisons aux murs de terre de la vieille ville » (p.201).
Voyez-vous là une description de « joyaux architecturaux » ? Moi j’y vois une description d’une insoutenable pauvreté à laquelle s’est attaqué le gouvernement. Évidemment, ce n’est pas sûr que Mme Haïtiwaji puisse véritablement s’en rendre compte, parce que les conditions économiques dans lesquelles elle a vécu au Xinjiang étaient bien différentes, comme nous le verrons plus bas.
Vous allez me dire : que faire d’habitations flambant neuves si plus d’un million de Ouïghour.es sont enfermé.es dans les camps et que les villes sont désertes ? C’est en effet ce qu’on peut lire dans la presse mainstream et qui est confirmé par Mme Haïtiwaji (p.132) lorsqu’elle parle des « rues vides d’un quartier de Karamay autrefois très fréquenté ». Sauf qu’elle se contredit une nouvelle fois et affirme ainsi, p.198, qu’après son séjour en camp elle retrouve avec « bonheur », la ville « identique à [s]es souvenirs ». Elle constate que « les restaurants et les commerces n’ont pas été délogés » (p.198 encore). Et donc ? Les villes sont désertes ou pas ? Que doit-on croire ?
D’aucuns diront que le PIB en croissance doit être imputé à une exploitation dommageable de la province. Effectivement, Gulbahar Haïtiwaji explique que « les communistes ont coulé du béton sur [leurs] routes caillouteuses et ouvert le ventre de la terre pour y puiser le pétrole et le gaz qui dormaient là » (p.21). Un pays encore en développement il y a peu qui décide de profiter pour lui-même de ses ressources naturelles, peut-on vraiment lui jeter la pierre ? Oui, même elle ne nie pas les investissements publics ; elle raconte qu’ils ont « creus[é] le lit d’une rivière artificielle » et qu’ils y ont « plant[é] des rangées d’arbres touffus » (p.26), des rangées d’arbres qui « s’allongeaient chaque année à mesure que la municipalité en plantait de nouveaux le long du canal » (p.199). En fait, « Karamay se développait » et « les offres de divertissement se multipliaient » (p.27).

On peut aimer ou pas les shopping malls mais Gulbahar trouvera quand même que faire ses courses au même endroit « c’est vrai que c’est bien pratique » (p.202), jusqu’à se retrouver dans une « euphorie fébrile » en achetant des chaussures après sa détention (p.203) et, face aux caissières, « dans un état cotonneux de bien-être » (p.205). On peut bien entendu comprendre que recouvrer sa dignité n’a rien de trivial après une détention mais pourquoi, alors, sur la même page, fustiger « l’empire de la fringue, de l’électroménager et du produit de beauté » ?
Quant au Xinjiang qui n’aurait plus rien à voir avec ce qu’il était quand la famille Haïtiwaji l’a quitté, ce n’est tout simplement pas vrai. Elle précise qu’aux « dernières nouvelles, certains travaillent encore à la Compagnie, [sont] professeurs à l’école ou à l’université » (p.27). Du coup, les Hans veulent-ils du bien ou du mal au Xinjiang et aux Ouïghours ? Voyons maintenant ce que Gulbahar dit des relations interethniques et de l’identité ouïghoure.
Hans, Ouïghours et identité ethnique
L’identité ouïghoure serait mise en danger par les autorités chinoises favorisant les Hans. En tant que minorité ethnique et religieuse, les Ouïghour.es « persécuté.es » seraient du bon côté, de celui qu’il faudrait moralement soutenir. Il est toutefois intéressant d’une part d’évaluer le traitement réservé aux Ouïghour.es selon ce qu’en dit Mme Haïtiwaji, d’autre part de voir comment elle-même parle des relations interethniques.
En ce qui concerne la fameuse « sinisation » (sur laquelle je reviens dans un article précédent), Gulbahar Haïtiwaji reconnaît n’en avoir « pas senti les influences s’abattre » sur elleux (p.200) à Karamay avant de s’expatrier et personne, toujours selon elle, n’aurait pu affirmer « avec conviction » les discriminations (p.68) dont les Ouïghour.es auraient été victimes. Avoir vécu « sous pavillon chinois » ne les a pas « empêch[és], bien longtemps, d’être des Ouïghours » (p.201). En fait, en Chine, les « Hans disent que les plus belles femmes du monde sont les Ouïghoures » (p.20) et, « Han ou Ouïghour, à cette époque, tout ça n’avait aucune importance » (p.25). Cela n’est finalement pas si différent de la profession de foi envers la Chine qu’on leur fait réciter dans le camp : « […] Je souhaite que toutes les ethnies forment une seule et grande nation » (p.92). Pas que toutes les ethnies n’en forment qu’une, non, que toutes les ethnies, dans leurs différences donc, forment une seule nation, c’est-à-dire une unité politique.
D’où viennent alors les « tensions communautaires » (p.22) ? D’un changement brutal de politique faisant dire à Gulbahar que la policière ouïghoure qui la surveille, dans sa résidence surveillée, la même qui « célèbre l’Aïd avec les siens et [qui], il n’y a pas si longtemps, […] priait sans redouter d’être enfermée, déportée, rééduquée » (p.184) est aujourd’hui « chargée d’éradiquer sa propre religion, sa langue, ses traditions » (p.184) ? Mais elle ne peut dire une chose pareille sur base de ce qu’il y a dans son propre témoignage, il y a trop de contradictions : l’Islam continue d’être pratiqué, la langue ouïghoure continue d’être écrite et parlée et les traditions persistent.

Pourquoi interprète-t-elle alors les vidéos de « Ouïghoures aux bras de Hans fringants et tout sourire » comme la preuve de « femmes probablement mariées de force » (p.121) ? Est-ce à ce point impensable de tomber amoureuse d’un homme de l’ethnie Han ? Est-ce à ce point impensable qu’un poste dévolu à un salarié Han (p.29) plutôt qu’à son mari soit le résultat d’une sélection honnête et non une preuve de discrimination ? Comment peut-elle à la fois dire qu’iels n’auraient pu affirmer les discriminations tout en demandant avec colère « à partir de combien d’humiliations, d’inégalités, d’injustices, faut-il taper du poing et s’exclamer : ça suffit ! » (p.30) ?
Il y a quelque chose qui m’échappe dans le rapport qu’entretiennent les Ouïghours à leur propre identité, si j’en crois les propos de Mme Haïtiwaji. Il est « inscrit que nous sommes des citoyens de la République populaire de Chine », dit-elle, « mais dans notre cœur nous sommes toujours des Ouïghours » (p.22). À aucun moment les propos qu’elle rapporte dans le livre et qui sont attribués aux Hans ou aux autorités ne disent le contraire ! En revanche, opposer l’identité ouïghoure et la nationalité chinoise ne dit-il pas quelque chose de ses positionnements politiques et de sa proximité idéologique avec le séparatisme du WUC ?
Pourquoi semble-t-elle regretter que dans les grandes villes « les ethnies [se mélangent] » (p.31) ? Regretter que Karamay soit une ville « aux attributs si peu ouïghours » (p.199) ? Que cherche-t-elle à préciser lorsqu’elle dit que « Kashgar est », au contraire « la ville la plus ouïghoure du Xinjiang » (p.199) ? Que « plus indépendantiste, plus traditionnelle », là où se pratique un Islam « plus fervent, plus dogmatique », Kashgar « éclabousse depuis des siècles le sud du Xinjiang de la culture ouïghoure » (p.199) ? Pourquoi trouve-t-elle pertinent d’ajouter que, Ouïghours et Hans, « nous n’avons pas les mêmes traits », « nous ne sommes pas le même peuple » ; que « leurs origines sont asiatiques » et « les nôtres turques » (p.57). Fort bien, et puis quoi ?
Venant d’un pays, la Belgique, dont l’unité est sans cesse menacée par les nationalistes flamands, ces phrases prennent une connotation bien trop familière lorsque je remplace « ouïghour » par « flamand ». Ces mêmes nationalistes flamands insistent pareillement sur « les différences » et les « spécificités culturelles » (p.23, p.200). Des spécificités qui, dans le cas des Ouïghours, incluent une domination des hommes sur les femmes faisant que c’est à la fille de Mme Haïtiwaji, Gulhumar, qu’il revient de faire, pendant la détention de sa mère, « la maîtresse de maison » et. après son travail, de « prévoi[r] les menus, rempli[r] le congélateur, passe[r] un plumeau sur les meubles endormis » pour regagner ensuite « épuisée »…son propre appartement de Nanterre (p.155, voir aussi p.154).
C’est le même nationalisme, flirtant avec le racisme, que l’on perçoit derrière l’opinion selon laquelle la nourriture des Hans a « un bruit dégoûtant » quand on la verse dans son bol (p.57), qu’une voix qui grésille dans le microphone ne peut que « dégueuler des phrases en mandarin » (p.58), ou encore lorsque Gulbahar semble choquée à l’idée qu’une femme de son ethnie puisse leur « apprendre à devenir chinoise » (p.92).
Est-ce toujours aussi étonnant qu’on puisse lui reprocher d’avoir « peu de considérations pour [son] pays » (p.145) ? Les Français.es trouvent-ils si normal qu’après 15 ans passés en France, elle ne parle toujours pas la langue du pays, comme on a pu le constater dans les nombreuses interviews données à l’occasion de la publication de son livre ?
Il est temps maintenant de se demander pourquoi la famille Haïtiwaji dit avoir émigré et quels ont été leurs rapports avec la Chine depuis leur installation en France. Rendez-vous dans la quatrième partie de notre grand dossier.
Merci à mes tipeurices : smart684, Rosie-6, gendre-daniel, g106973983737661016119, fillon, eva-17, jean-do-5b8e, marsxyz, f-ines-5a3f79, Wen, Laetitia, Eva-17, Bernard-227
Pour me soutenir avec un pourboire, suivez ce lien.
Source : Le blog du Radis
https://leblogduradis.com/…